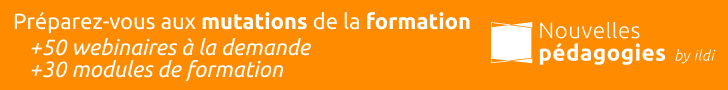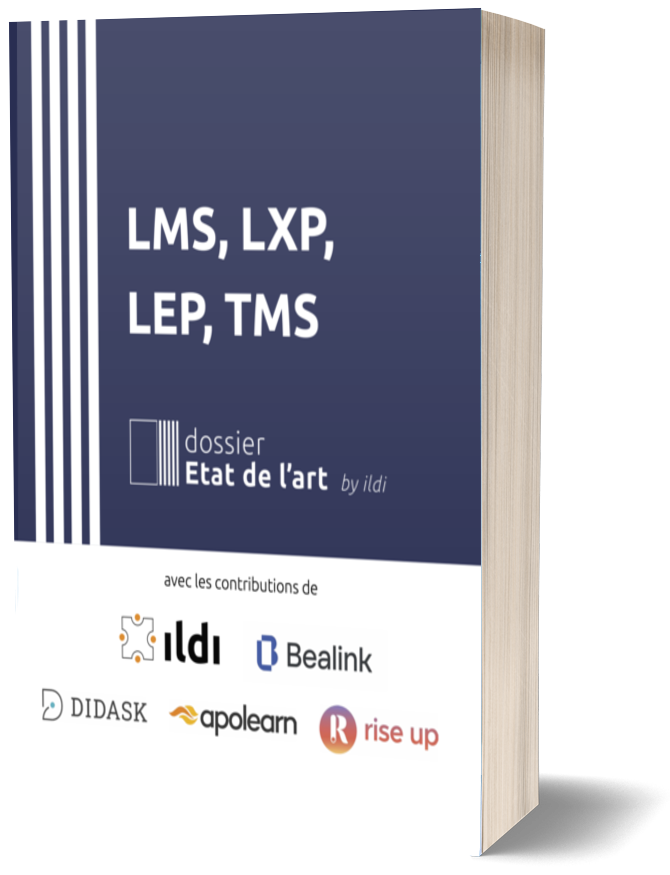Publié dans : Méthodes et organisation
La numérisation universelle en cours bouleverse notre rapport aux documents historiques, à la mémoire et aux savoirs. Une question essentielle se pose : comment créer un patrimoine numérique qui soit à la fois pérenne, éthique, accessible, authentique et respectueux de la protection des données ?
La prolifération des données : un obstacle à la pensée claire ?
À l’ère du numérique, un impératif semble s’imposer, tout doit être conservé : archives historiques, souvenirs personnels, documents culturels. Cette accumulation vise peut-être à construire une mémoire collective virtuelle, mais pose un paradoxe : en voulant tout retenir, ne risquons-nous pas de nous perdre dans une surcharge d’informations ? Cette surabondance, qualifiée « infobésité », noie souvent les données essentielles parmi une multitude de contenus secondaires, rendant leur tri et leur hiérarchisation complexes. Les utilisateurs, constamment sollicités, peinent à se concentrer et accordent autant d’importance aux informations secondaires qu’aux contenus majeurs. Dans le domaine patrimonial, cette masse de données crée une confusion plutôt qu’une clarification.
L’IA : une appropriation opaque des savoirs
L’intelligence artificielle exploite d’énormes quantités de données, y compris des œuvres protégées, souvent sans l’autorisation des auteurs, soulevant ainsi des questions juridiques et éthiques. Toute information peut être utilisée pour générer du contenu, faisant des données une ressource clé de l’économie numérique. Cette logique marchande déconnecte les savoirs de leur valeur culturelle et scientifique d’origine. L’exploitation des contenus dans un but commercial entraîne leur décontextualisation et les transforme en simples marchandises au service des intérêts des géants du numérique.
Penser la numérisation, un enjeu politique et culturel
La numérisation des archives de Bruno Latour met en lumière un dilemme contemporain : offrir un accès élargi aux savoirs tout en restant tributaire d’infrastructures énergivores et de plates-formes privées qui contrôlent l’information. Loin d’être immatériel, le numérique repose sur des ressources limitées et renforce des logiques de pouvoir qui interrogent son impact écologique, politique et culturel. Bruno Latour nous inviterait à « atterrir », c’est-à-dire à prendre conscience des implications matérielles et systémiques de ces choix.
Plutôt que d’accumuler sans réflexion, il est essentiel de concevoir la numérisation comme un projet politique pour s’interroger sur la possibilité d’un accès aux savoirs durable et indépendant.