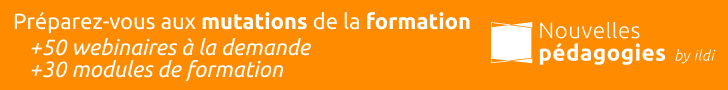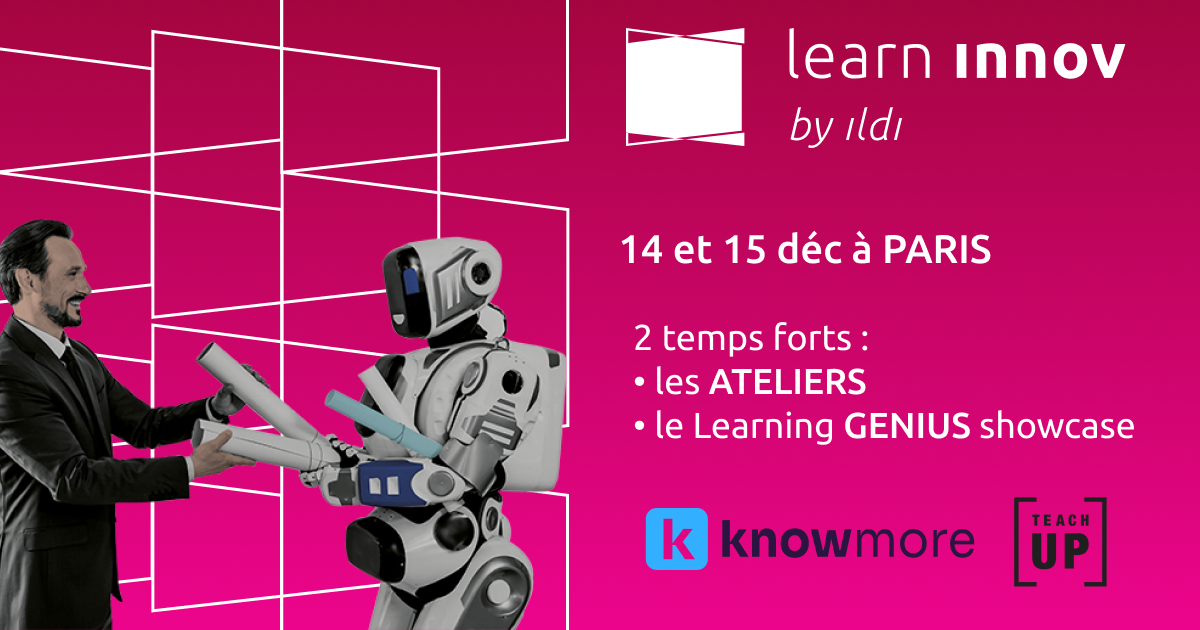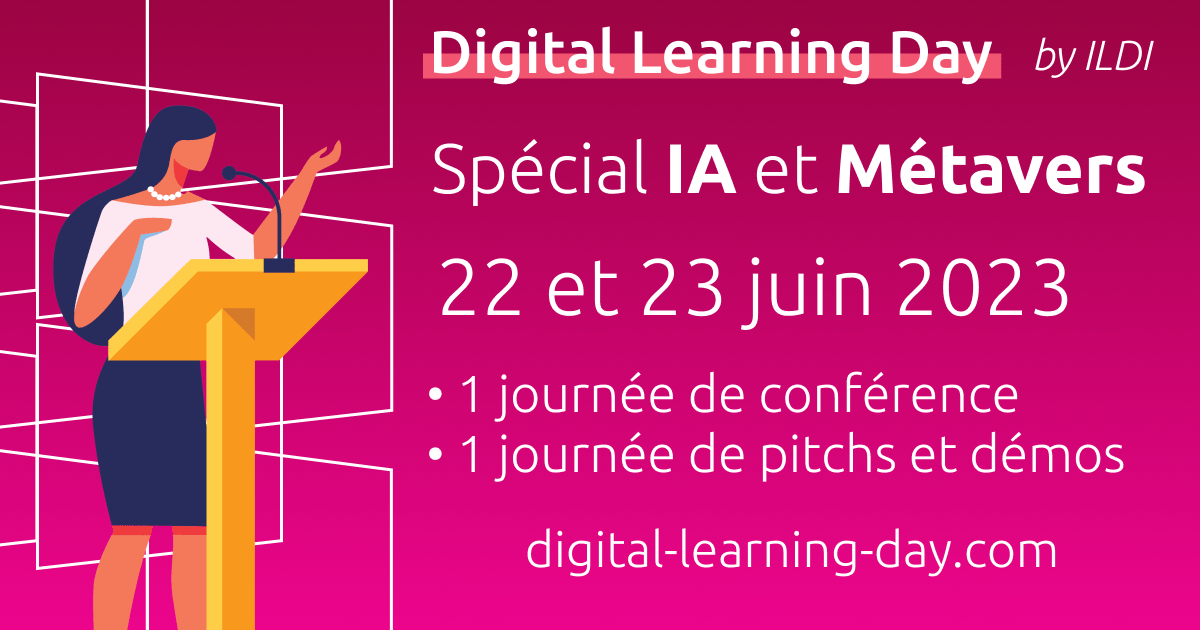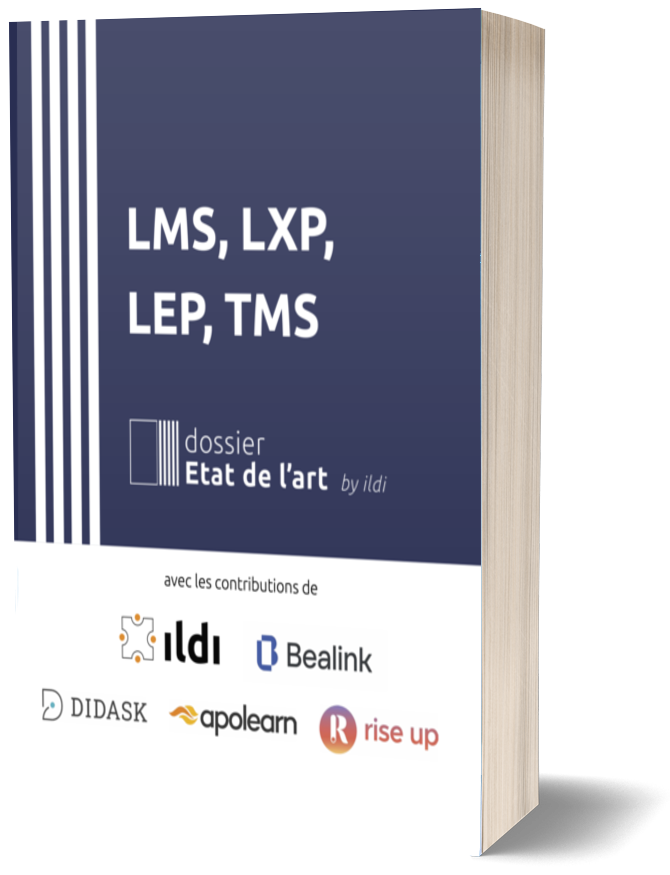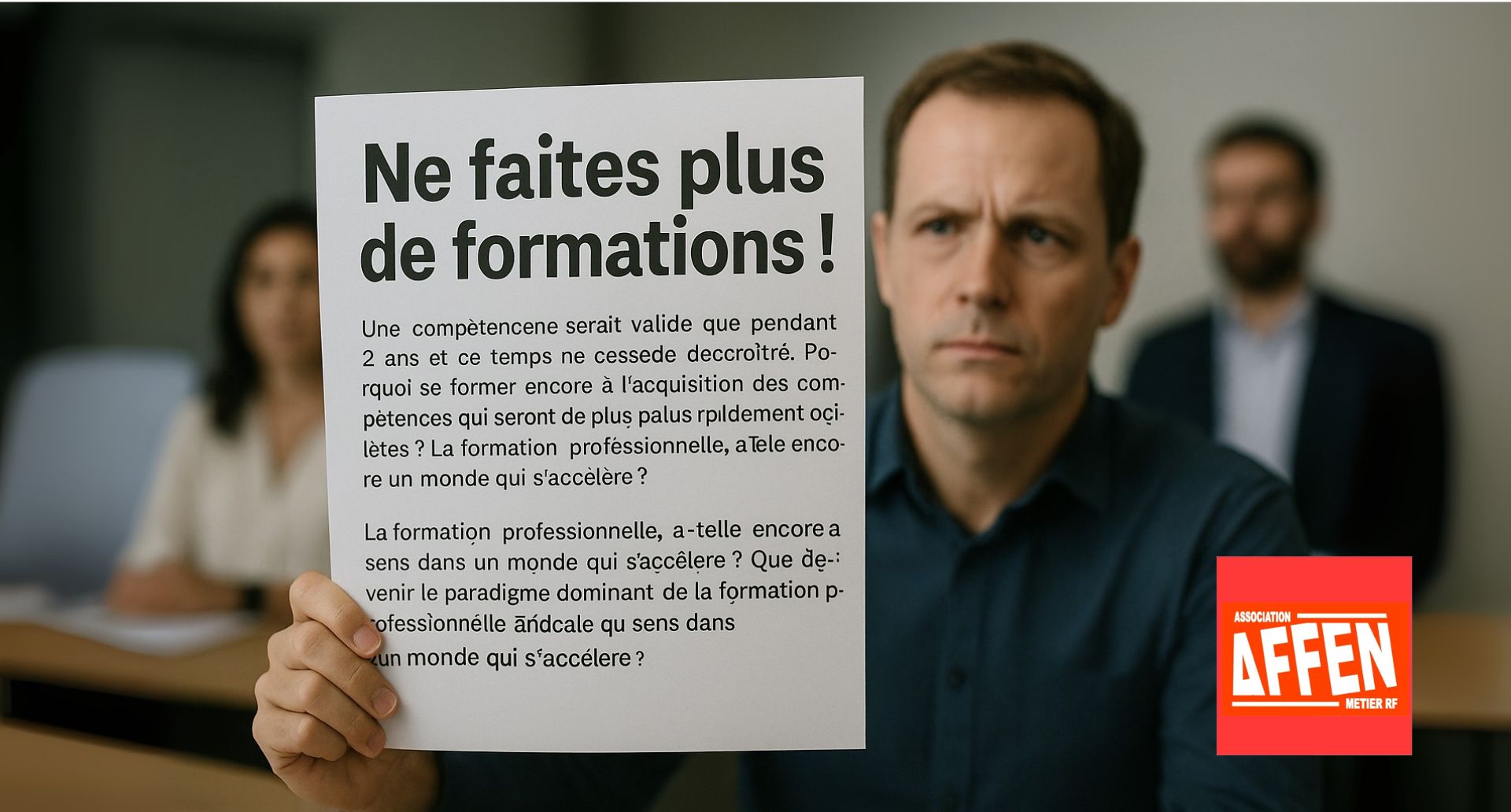
Publié dans : Méthodes et organisation
Pourquoi se former encore à l’acquisition des compétences qui seront de plus en plus rapidement obsolètes ? L’OCDE a produit un rapport en 2024 qui montre qu’aujourd’hui, une compétence acquise ne resterait valide que pendant 2 ans, et ce temps ne cesse tendanciellement à se réduire. Pourquoi lancer une politique de compétences, lorsque l’on sait qu’une fois réalisée, elle sera déjà obsolète ? La formation professionnelle, a-t-elle encore un sens dans un monde qui s’accélère ? Que devient le paradigme dominant de la formation professionnelle du 20ième siècle ? Laurent Alexandre et Olivier Babeau, de l’Institut Sapiens, proposent une livre décoiffant « Ne faites plus d’études ! Apprendre autrement à l’ère de l’IA » (https://www.buchetchastel.fr/catalogue/ne-faites-plus-detudes/). Leur thèse est centrée sur la formation initiale, mais peut trouver un bel écho dans le champ de la formation professionnelle qui connaît les mêmes interrogations. Que penser de leur thèse ? Comment se positionner face à la révolution de l’IA ?
Les critiques
Les auteurs annoncent un changement de paradigme au sens de Thomas Khun (La structure des révolutions scientifiques, 1962). Selon lui, un changement de paradigme est nécessaire quand l’ensemble de théories, des croyances et des techniques de la discipline accumulent des anomalies et que les modèles n’arrivent plus à expliquer la réalité. L’apprentissage traditionnel avec les cours, les diplômes,… sont obsolètes il faut en inventer un nouveau. La futurologie de la formation est souvent un bon levier pour imaginer le paradigme à construire. La première critique porte sur le fait de ne pas aller assez loin dans la futurologie, l’homme-machine est envisageable, c’est l’idée d’Elon Musk et Neuralik qui implante la machine dans l’homme et fait du processus d’apprentissage un processus de téléchargement, l’homme est capable de télécharger connaissances et compétences en temps réel, évacuant tout obsolescence. Bien se former, c’est avoir une bonne bande passante. Ce n’est d’ailleurs pas sans poser d’autres types de questions, tout aussi intéressant.
Que peut-on en penser ?
Le livre s’inscrit dans un cadre de pensée libérale, loin de critiquer le choix d’un cadre idéologique au profit d’un autre, il est toujours intéressant de le confronter aux cadres idéologiques alternatifs. Si les auteurs pensent l’apprenant comme un entrepreneur de ses apprentissages et que les choix soient des choix plus ou moins rationnels, d’autres comme Pierre Bourdieu et Jean-Christophe Passeron (La reproduction, 1970) dans un autre cadre de pensées montre que la notion de capital culturel change la donne dans l’arbitrage individuel. Pour eux, l’émiettement des apprenants se traduit par une reproduction globale des inégalités qu’ils condamnent. La formation qui par définition est un apprentissage socialisé, ne peut se réduire à une addition d’expériences individuelles, elle doit être aussi pensée comme un projet collectif qui fasse sens pour chaque individu, sinon on est restreint à réduire l’homme à l’homo oeconomicus pour construire ses optimums.