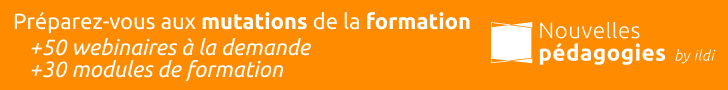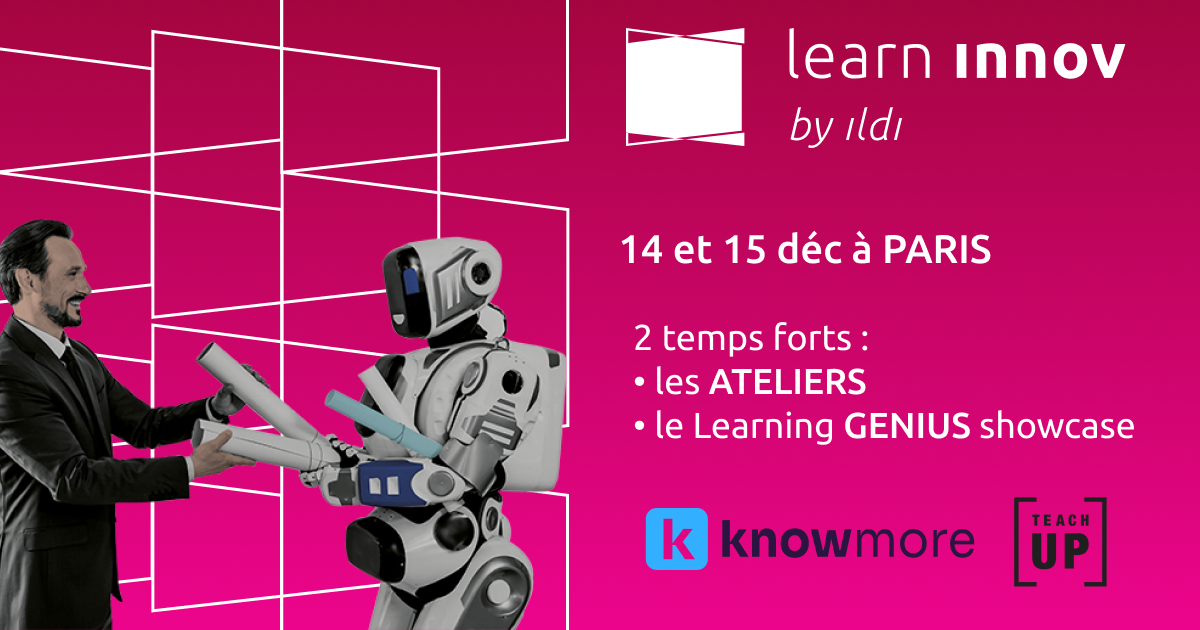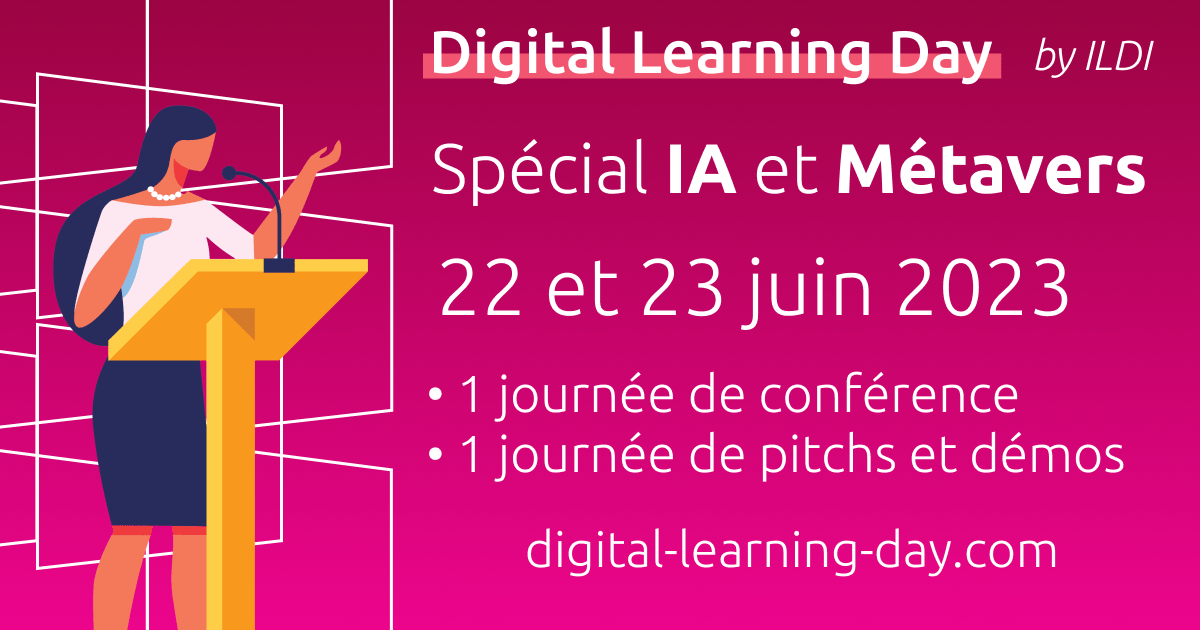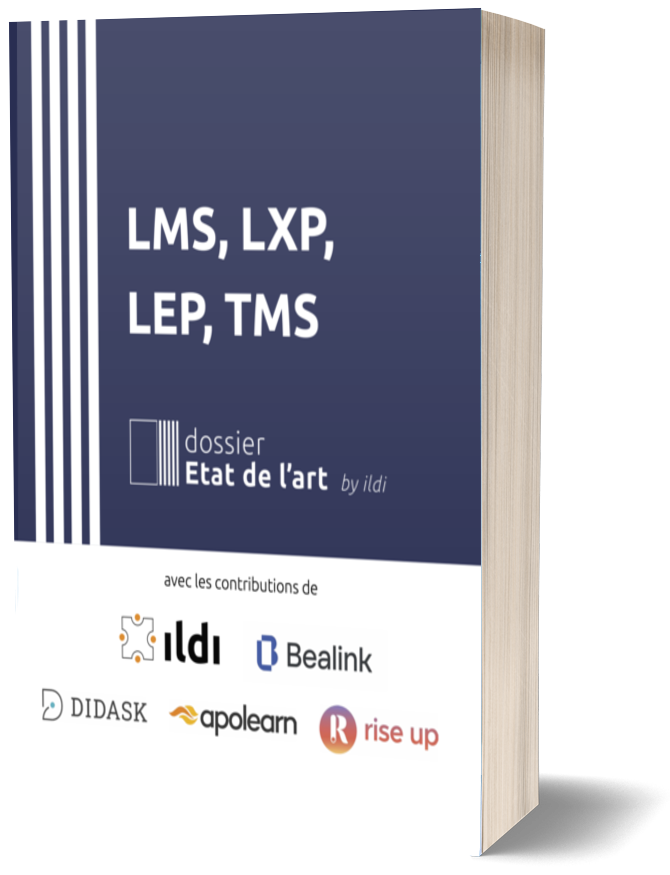Publié dans : Pédagogie
Mais de quoi les « savoir-être » sont-ils le nom ? Souvent mal définis et renvoyant à des notions floues, ils sont peut-être, d’abord, le révélateur de ce qu’est vraiment le process de recrutement : une négociation entre manager et recruteur et un moment de cristallisation des besoins en compétences de l’organisation.
Une absence de définition claire
Une revue systématique de la littérature scientifique montre que seulement 11 % des articles publiés dans les revues de management entre 2014 et 2019 proposent une définition claire des soft skills (ou savoir-être). Près de la moitié ne mobilise aucun cadre théorique, les autres s’éparpillant sur cinquante théories différentes. Du côté des entreprises, les compétences comportementales sont rarement définies et décrites avec précision. Leur évaluation est majoritairement livrée à des appréciations subjectives, quand elle n’est pas confiée, pire, à un test de personnalité.
Des savoir-être à double face
Les compétences sont souvent assimilées à un stock individuel de caractéristiques internes et stables. Ces caractéristiques déterminent des comportements et des performances en situation de travail. La stabilité des compétences rend possible une évaluation standardisée ; elle donne aux recruteurs un sentiment d’objectivité et fonde leur légitimité professionnelle. Mais les compétences sont aussi des constructions sociales. Elles émergent et prennent leur sens dans une configuration singulière de vocabulaire, de normes et d’attentes.
Une diplomatie du recrutement
Le travail réel du recruteur consiste alors à orchestrer un subtil équilibre entre des exigences contradictoires. Son expertise ne réside pas tant dans l’application mécanique de grilles d’évaluation que dans sa capacité à traduire, filtrer et reformuler les demandes managériales. Il devient un interprète des tensions organisationnelles. Il doit décoder les attentes implicites du manager tout en préservant le cadre légal et éthique du recrutement.