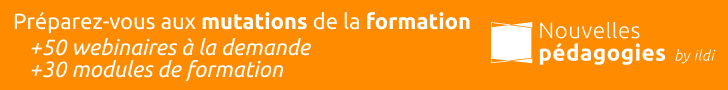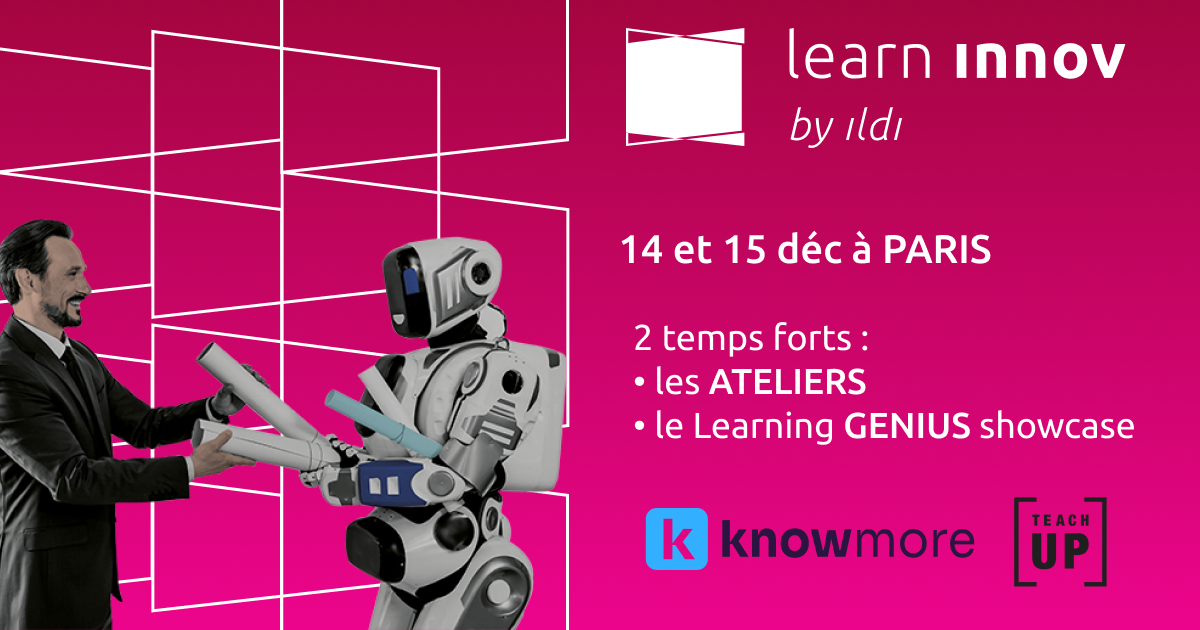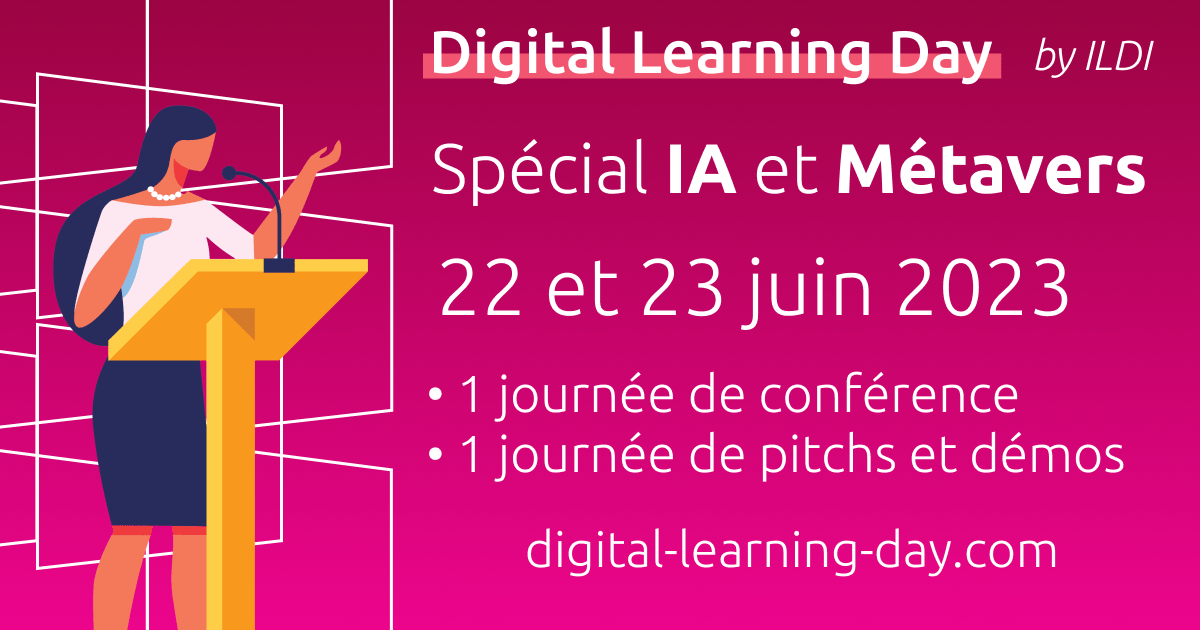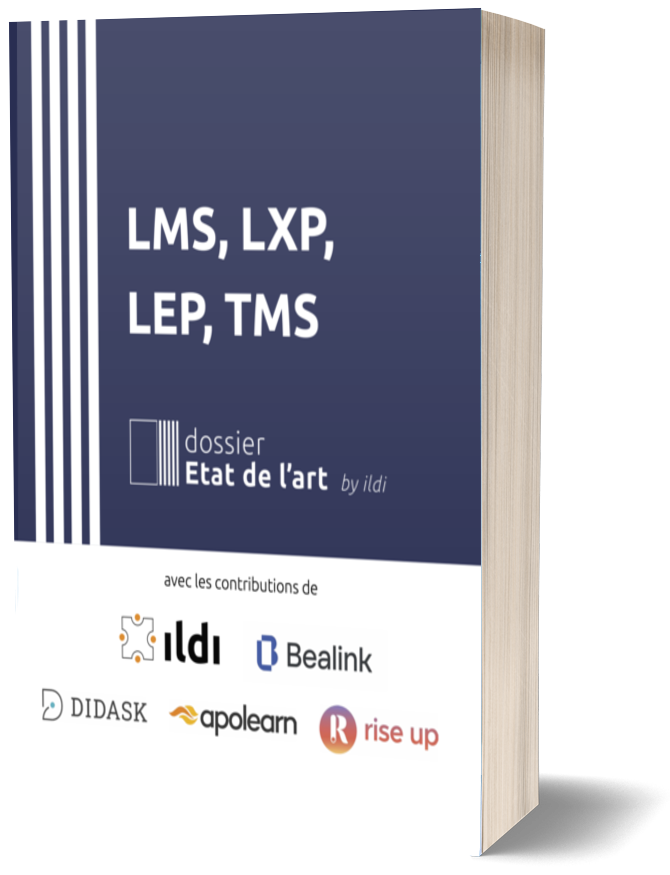Publié dans : Méthodes et organisation
Étudier serait devenu un problème. Alors qu’aux États-Unis, des conservateurs proches de Donald Trump accusent l’université de retarder la fondation des familles, certains proposent en France de raccourcir la durée des études pour relancer l’activité et la natalité. Mais la durée des études a-t-elle vraiment augmenté ? Pour quels bénéfices économiques et sociaux ?
L’enseignement supérieur fait l’objet d’attaques nouvelles et plurielles. Il ne s’agit pas seulement d’une attaque concernant les libertés académiques ou la place respective du public et du privé. Il s’agit aujourd’hui de remettre en cause l’utilité même de l’enseignement supérieur.
Pourquoi les critiques donnent-elles l’impression que les jeunes feraient des études de plus en plus longues ? En réalité, il ne faut pas confondre l’âge de fin d’études et l’accès aux diplômes. C’est là que s’inscrit le débat sur « l’inflation des diplômes », porté bien au-delà des clivages partisans.
L’argument est connu : l’augmentation du nombre de diplômés réduirait la valeur relative des titres scolaires, générant une frustration, en particulier chez les « nouveaux diplômés » issus des milieux les moins favorisés scolairement. La massification scolaire serait ainsi un piège.
Effet signal et gains de productivité
D’autres travaux, comme ceux de David Card, 2001,confirment ce résultat. Le consensus actuel, fondé sur de nombreuses « expériences naturelles », est que les rendements de l’éducation sont élevés. Pour un individu donné, les rendements privés de l’éducation sont de l’ordre de 8 % de salaire supplémentaire par année d’études, dont environ deux tiers relèvent d’un gain réel de productivité et un tiers d’un effet de signal (Aryal, Bhullere et Lange, 2019). Autrement dit, l’éducation reste un investissement rentable, à la fois pour les individus et pour la société.
Le vrai problème est ailleurs. Depuis la génération née en 1975, l’investissement dans l’éducation stagne. Cela pourrait contribuer à expliquer la faible croissance française actuelle.
Réduire l’enseignement supérieur aujourd’hui reviendrait, pour les futures générations d’étudiant, à scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis et se priver d’une source de financement des retraites des quinquagénaires actuels.
Vers un revenu étudiant ?
Il est vrai que suivre des études supérieures retarde en moyenne l’âge du premier enfant. Mais cela n’entraîne pas une baisse de la fécondité. En 2009, l’indice conjoncturel de fécondité (ICF) était de 1,8 pour les diplômées du baccalauréat, et… exactement le même chiffre pour les diplômées du supérieur (INED.
Plutôt que la coercition technocratique, c’est en renforçant leur autonomie que l’on permettra aux jeunes d’avoir le nombre d’enfants qu’ils souhaitent réellement. Le programme pour l’autonomie et l’égalité des jeunes demeure, hélas, d’une brûlante actualité.