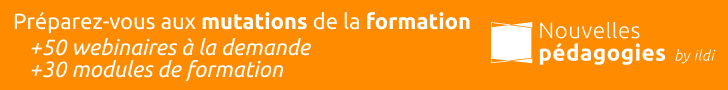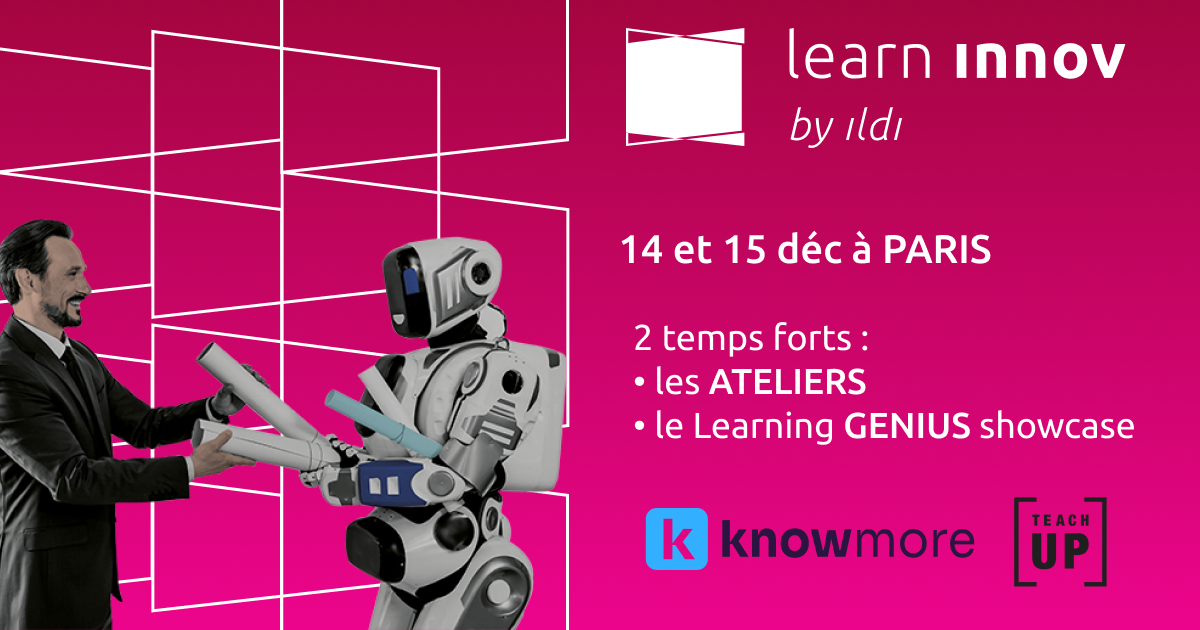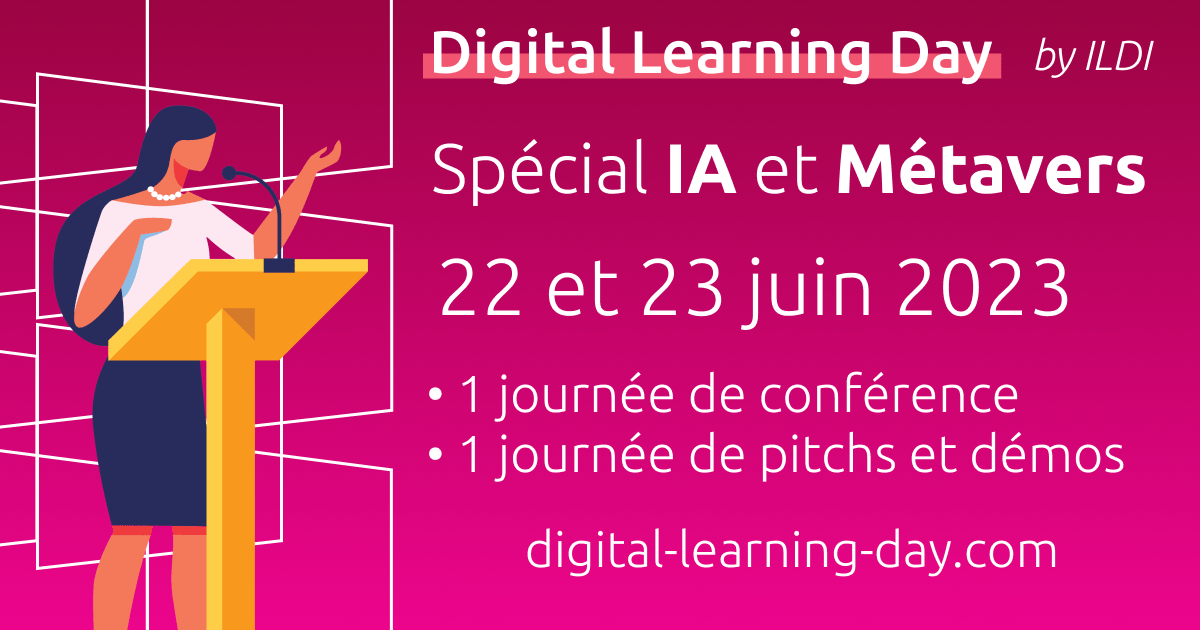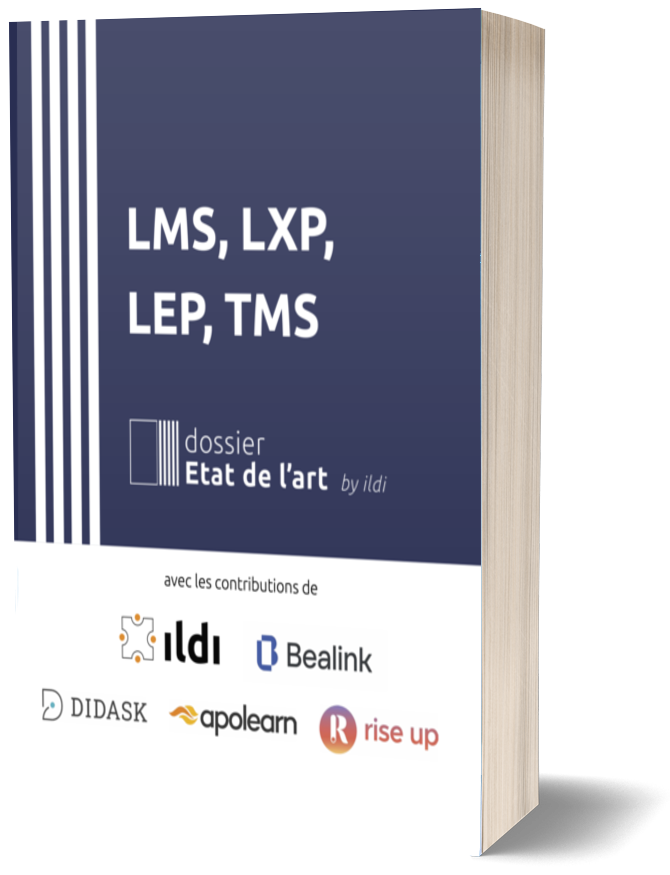Publié dans : Pédagogie
La mode participative : l’ultra solution
Convention citoyenne, grand débat, cahiers de doléances, référendum… consulte t’on chacun pour mettre une dose d’horizontalité dans un monde perçu par trop hiérarchique? Dans la rhétorique contemporaine de la gouvernance participative, la facilitation apparaît comme un art de faire parler, un levier pour faire advenir l’intelligence collective, un garant de la coopération dans les collectifs.
Mais dès lors que cette pratique se systématise et s’institutionnalise, elle engendre des zones grises. C’est dans cet interstice qu’émerge la notion de «facipulation», forgée dans les années 2010 par des praticiens critiques des démarches participatives, notamment au sein de mouvements d’éducation populaire, de collectifs citoyens et de consultants engagés dans les processus de transition démocratique.
Les atours du pouvoir
La facipulation n’est donc pas un dévoiement anecdotique de la facilitation, mais une possibilité inhérente à toute pratique qui prétend « faire parler » un collectif. Elle constitue un risque structurel dès lors que le facilitateur n’explicite pas son cadre d’intervention, ses finalités, ou les intérêts qui traversent le processus. La croyance dans la neutralité méthodologique crée un angle mort critique, que les acteurs les plus stratégiques peuvent exploiter.
La facilitation peut être un art de l’émancipation ou un masque élégant du pouvoir. C’est de la vigilance éthique et politique des praticiens, et de la capacité des collectifs à interroger les dispositifs qui les gouvernent, que dépend l’avenir de cette pratique.