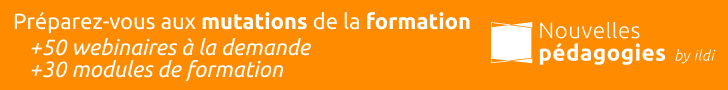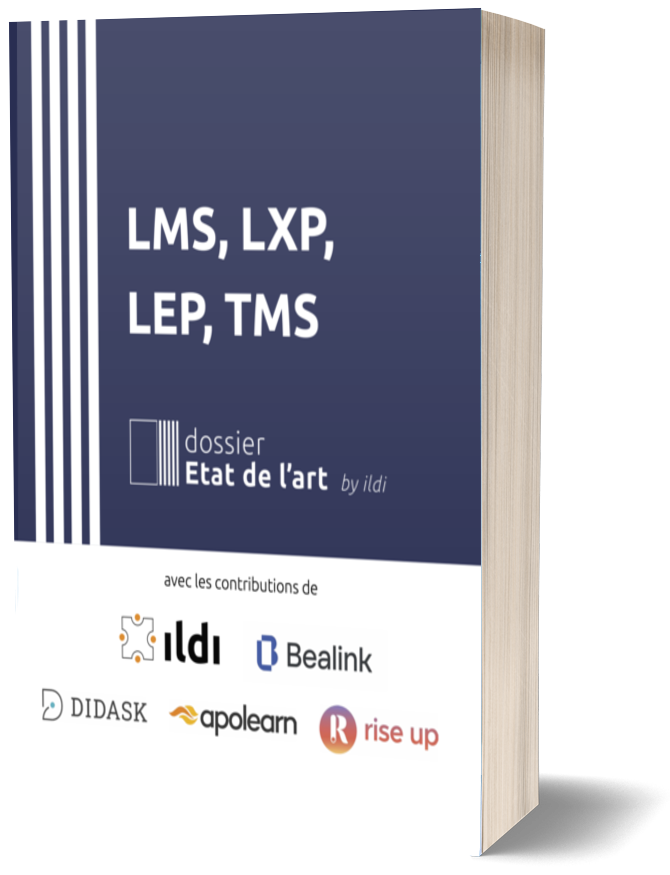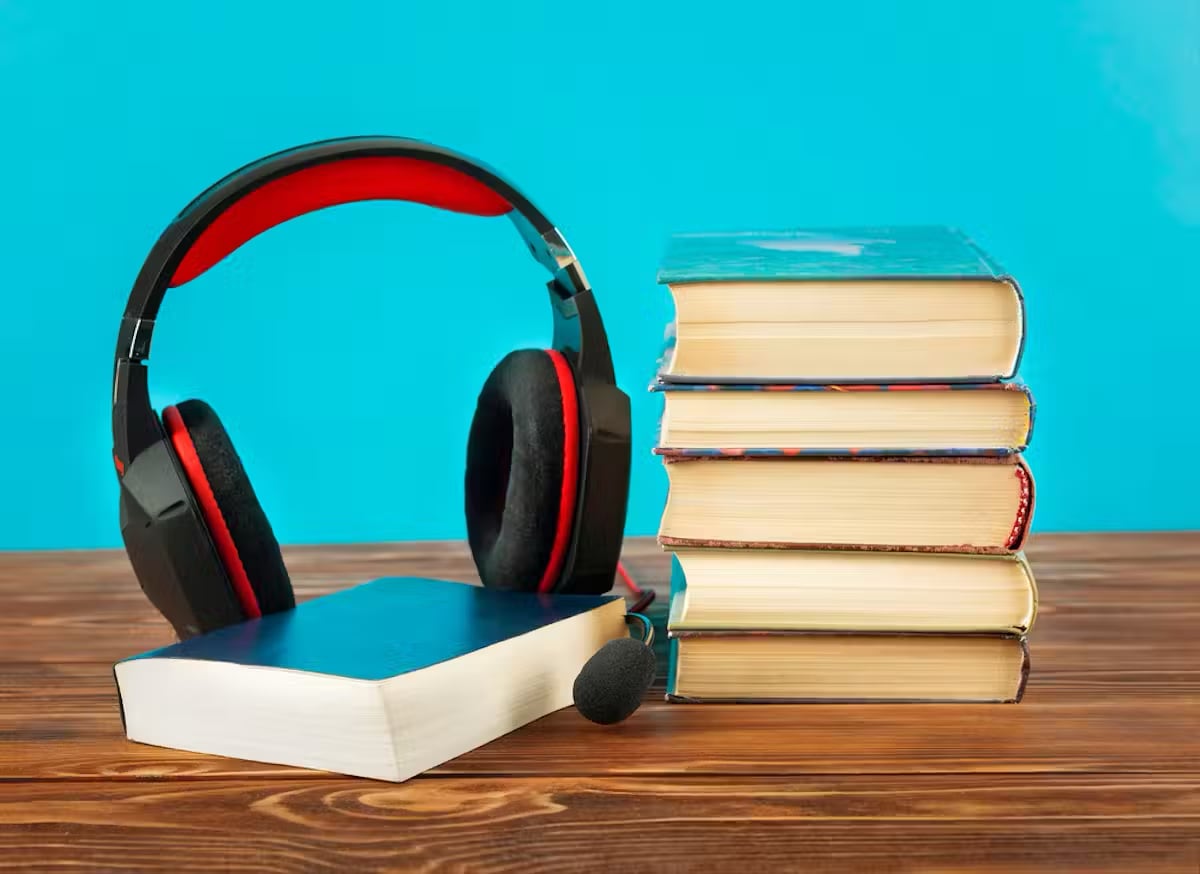
Publié dans : Cognition et Communication
La lecture d’un texte à voix haute l’enrichit d’une interprétation et d’une dimension émotionnelle. Mais dans quelle mesure l’écoute d’un livre en format audio aide-t-elle à mieux comprendre un texte ? Peut-elle concurrencer des pratiques de lecture classiques dans un cadre scolaire ?
Lire ou écouter : des différences limitées en apparence
Dans une méta-analyse publiée dans la Review of Educational Research et prenant en compte les résultats de 46 études menées entre 1955 et 2020, incluant au total 4 687 participants enfants et adultes, Virginia Clinton-Lisell, enseignante-chercheuse en psychologie de l’éducation à l’Université du Dakota du Nord, constate que les niveaux de compréhension ne diffèrent pas significativement lorsque les mêmes textes sont lus ou écoutés.
Adapter son rythme avec la lecture classique
Cependant, la méta-analyse de Clinton-Lisell souligne aussi que la compréhension devient meilleure en lecture qu’en écoute lorsque les participants peuvent lire à leur propre rythme. La lecture offre en effet la possibilité d’ajuster librement sa vitesse : ralentir face à une difficulté, revenir en arrière ou vérifier une information. Ce contrôle cognitif n’est pas possible lors de l’écoute d’un texte dont le rythme est fixé, sans possibilité de retour en arrière aussi naturelle.
Avec l’écoute, une dimension émotionnelle
L’écoute d’un texte présente toutefois certains avantages, notamment sur le plan de l’expérience vécue.
Elle implique la perception de voix, d’intonations et de prosodies qui, pour les personnes qui y sont sensibles, apportent une dimension affective et émotionnelle plus directe que la lecture silencieuse. Elle peut également faciliter l’accès au texte pour des élèves en difficulté de lecture, en réduisant la charge visuelle et en soutenant la continuité de l’attention.
Former un assemblage cognitif vertueux
Lire un texte ou l’écouter relève de formes distinctes d’assemblages cognitifs, chacun mobilisant différemment nos sens, notre attention, notre mémoire et nos émotions. Apprendre à reconnaître ces différences – et à choisir la modalité la plus adaptée selon le but visé (lecture approfondie ou écoute immersive) et selon nos préférences (exploration plutôt visuelle et tactile, voire olfactive, ou auditive) – revient à former un assemblage cognitif vertueux, capable de tirer parti de la richesse de chaque mode d’interaction avec le langage et la culture.
Savoir quand lire, quand écouter et comment passer de l’un à l’autre – voire combiner les deux modes –, c’est apprendre à ajuster sa manière d’apprendre, et, plus largement, à penser par soi-même.