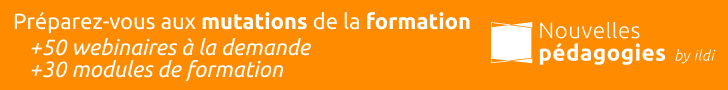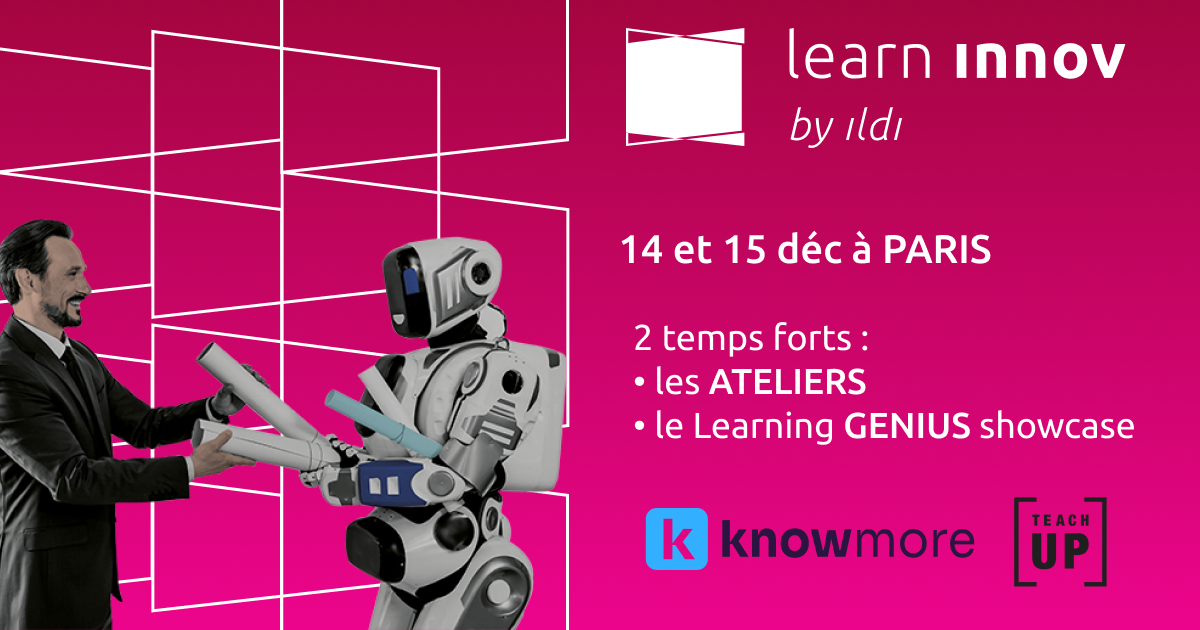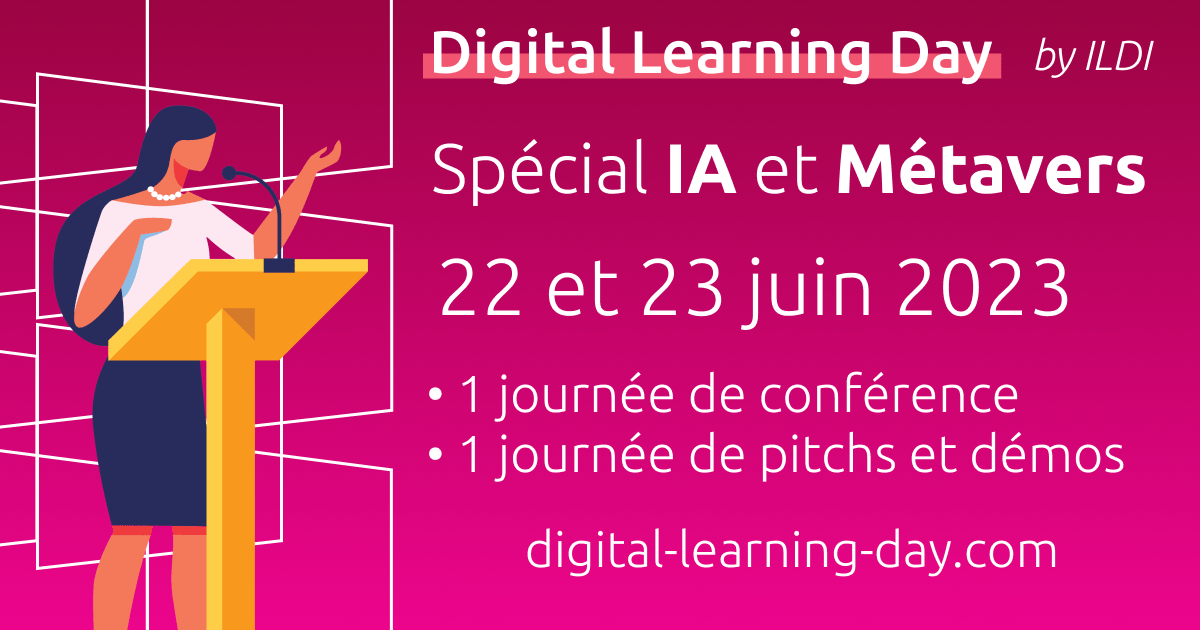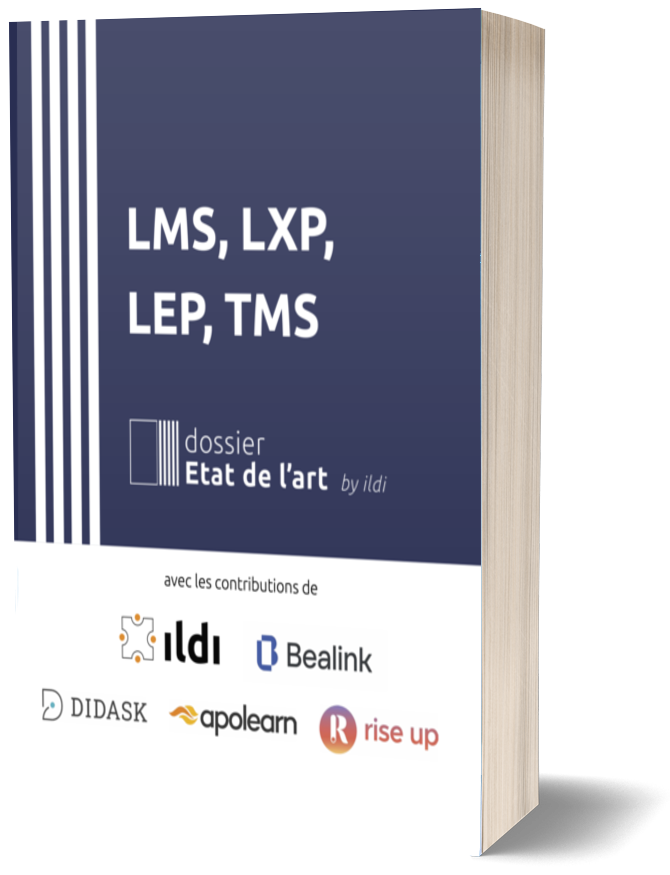Publié dans : Méthodes et organisation
Le 3 septembre, des experts du monde entier se sont réunis pour la session intitulée « Les ressources éducatives libres comme biens publics numériques : mettre en œuvre la Déclaration de Dubaï grâce à l’intelligence artificielle et aux technologies émergentes ». Cette rencontre a permis d’explorer comment l’ouverture peut orienter les systèmes éducatifs à l’ère des transformations technologiques rapides.
Les débats ont souligné que, bien souvent, la régulation peine à suivre le rythme de l’innovation, alors que les REL offrent un cadre résilient pour inscrire l’équité, la qualité et la participation au cœur de l’éducation. Les intervenants ont abordé plusieurs défis majeurs, tels que la dépendance à l’égard des plateformes commerciales, la fragmentation des dépôts de ressources et la faiblesse des modèles de gouvernance. Parallèlement, ils ont mis en avant les opportunités de renforcer la souveraineté numérique, de reprendre la main sur les outils et de bâtir des écosystèmes numériques partagés fondés sur l’ouverture.
Les discussions se sont tournées vers la question de la maîtrise des outils numériques dans l’éducation. Tel Amiel, titulaire de la Chaire UNESCO en éducation ouverte et technologies pour le bien commun à l’Université de Brasília, a présenté des données montrant que la majorité des universités d’Afrique et d’Amérique latine dépendent des systèmes Microsoft ou Google pour leurs infrastructures numériques. Une situation qui, selon lui, fait peser un risque sur la souveraineté numérique, car « la sphère commerciale et le bien commun tirent dans des directions opposées ».
Javiera Atenas, Maîtresse de conférences à l’Université de Suffolk, a élargi la réflexion en rappelant que les REL ne concernent pas uniquement le contenu, mais aussi la gouvernance. Elle a souligné la nécessité d’intégrer les principes FAIR (Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, Réutilisables) et les principes CARE (Bénéfice collectif, Autorité de contrôle, Responsabilité, Éthique) afin de bâtir des écosystèmes ouverts inclusifs, durables et portés par les communautés. « Nous avons de l’agence, de l’autodétermination, et nous devons permettre à nos apprenants d’accéder au savoir de manière démocratique et équitable », a-t-elle affirmé.
Le débat a clairement montré que les REL ne se résument pas à des ressources gratuites, mais qu’elles concernent avant tout la souveraineté, la durabilité et la capacité d’agir. En reliant la Recommandation de 2019 à la Déclaration de Dubaï, les participants ont mis en lumière à la fois les risques de dépendance et les opportunités de concevoir l’apprentissage numérique comme un véritable bien public mondial.