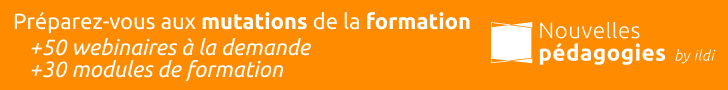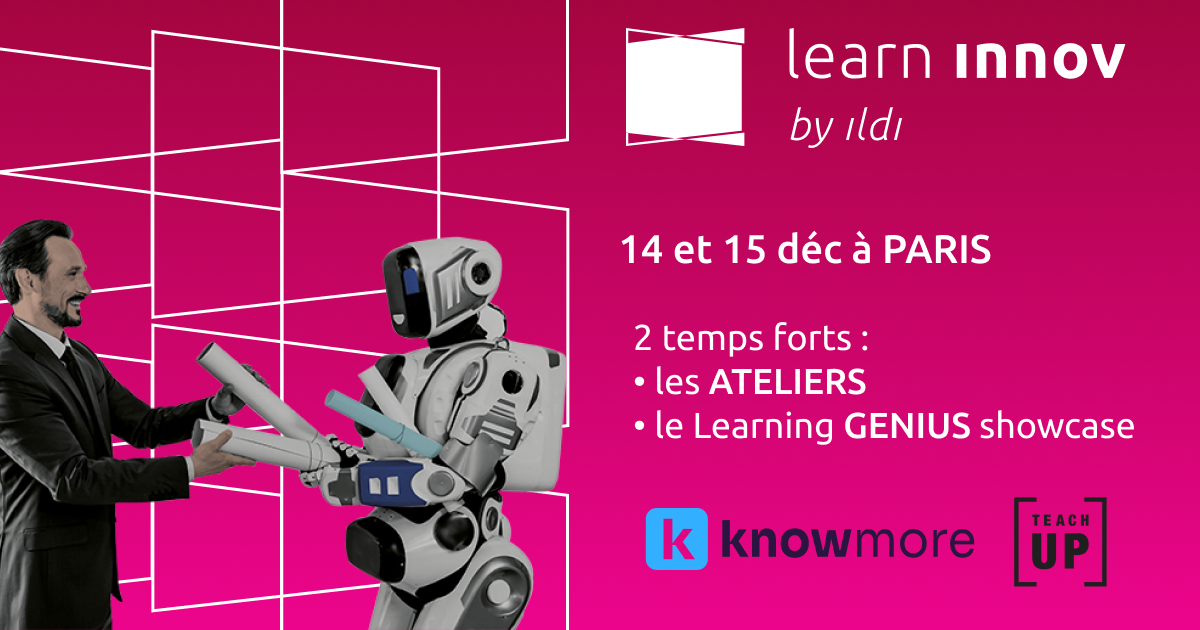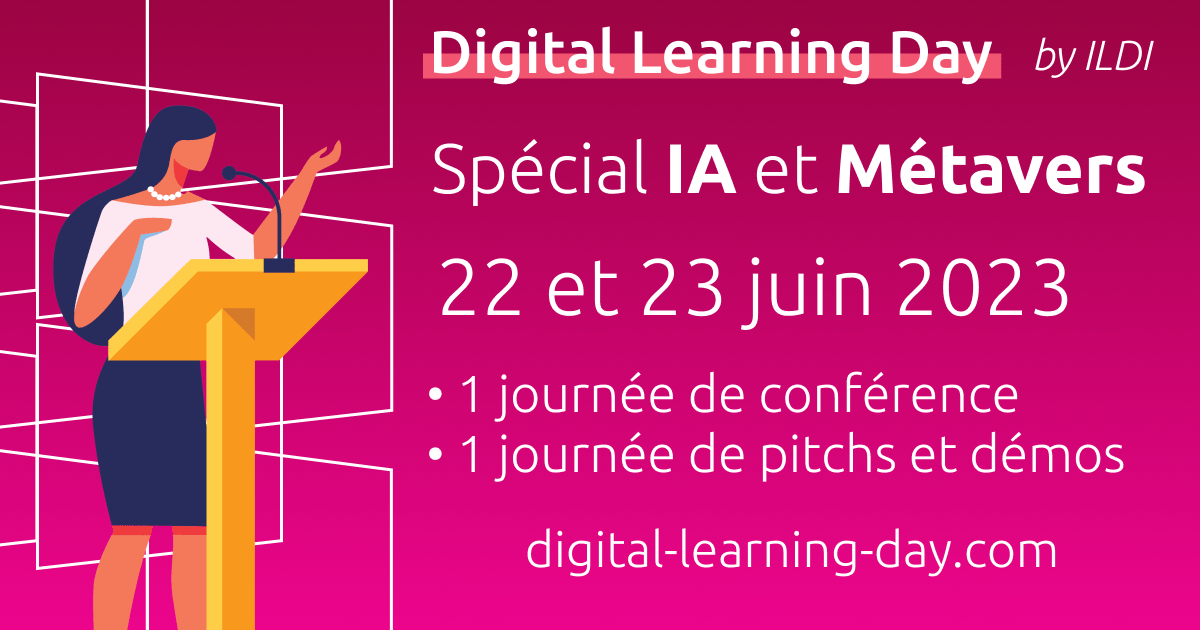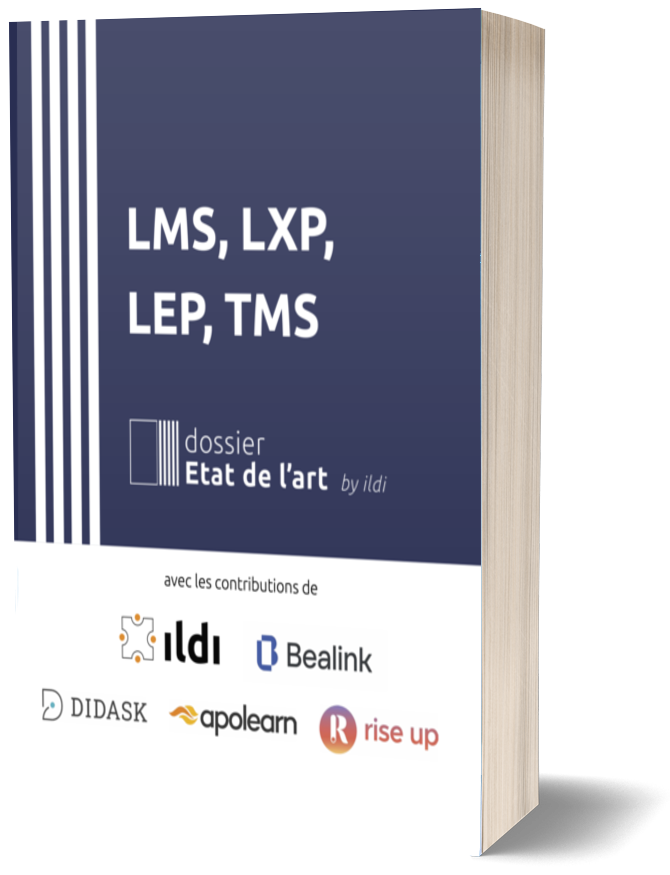Publié dans : Pédagogie
Le snack content a fait son entrée en France via la communication numérique en 2015 avec son ambassadeur, le créateur de contenu, Simon Cachera. Dans un monde où l’attention pose de plus en plus de problème, il propose une solution bien adaptée : des contenus courts, immédiatement accessibles, faciles à consommer.
Or selon le Rapport Metricool 2025, sorti le 6 octobre 2025, le content n’est plus ce qu’il était : les vidéos courtes explosent, mais l’impact s’effondre. 2025, sera-t-elle l’année du retournement ? Le retour des formats longs ? Comment la pédagogie doit-elle réagir face à ce phénomène ? S’agit-il de la fin d’un cycle, et de l’émergence d’un nouveau ? Que faut-il en penser ?
1, Le snack content ou la pédagogie fast-food
La pédagogie fast-food est une liberté nouvelle offerte aux apprenants, apprenez quand vous voulez. Et si le micro-learning est bien écrit, alors l’attention est captée et c’est le début du processus d’apprentissage. La pédagogie distribuée dans le temps et dans l’espace permet parfois une efficacité plus forte que la pédagogie massifiée.
L’économie de l’attention, substrat du snack content, se traduit par un affaiblissement de la capacité de chaque apprenant à devenir un être pensant, autonome, capable de construire des projets. Bernard Steigler parle même de « désindividuation ». L’individuation étant un processus continu par lequel un individu se forme, la désindividuation est un processus psychologique par lequel l’individu perd sa conscience de soi, son identité individuelle. Pour ces auteurs, le snack content réduit l’autonomie de l’apprenant à se construire, la fameuse conscientisation des apprentissages.
2, Un besoin de temps long
La raison pour laquelle en même temps que l’on assiste à l’explosion des formats courts, on assiste aussi à la montée en puissance des formats longs. Le magazine The conversation qui présente une version courte et une version longue, plus de 1 500 mots, affirme que la version longue génère plus de clic que ses versions courtes. Il ne s’agit pas d’une nostalgie d’une autre façon d’apprendre dans un monde qui s’est accéléré, mais d’une adaptation à la saturation. Le temps long permet de développer un point de vue, de raconter une histoire, d’offrir des nuances. Le savoir fragmenté lasse, le savoir raconté captive. L’apprenant a besoin qu’on lui raconte une histoire. « Le storytelling ne consiste pas à divertir, mais à structurer l’expérience » (Christian Salmon, Storytelling, 2007). La pédagogie ne consiste pas seulement à capter l’attention, mais à structurer les apprentissages.
Le raisonnement sur les formats, courts ou longs, est un héritage du XXe siècle. Il repose sur une vision statique du contenu, où l’essentiel est déjà défini, prêt à être diffusé. Une fois le message stabilisé, il ne resterait qu’à choisir le canal et la durée optimaux pour toucher un public supposé homogène. Mais le XXIe siècle commence par la disruption où l’ancien paradigme de la transmission laisse place à de nouvelles formes d’apprentissage. Comme le soulignait Michel Serres, « nos institutions sont fondées sur la rareté de l’information ; or, cette rareté a disparu » (Petite poucette, 2012). L’expert cède sa place à l’apprenant comme figure centrale du processus. Ce dernier attend des learner experiences qui associent tout à la fois la raison, l’émotion et la relation. Le learnal branding est un outil du 21ème siècle, encore faut-il avoir le courage de dire quelque chose qui fasse sens, la question devient alors pour quelle société je milite dans ce monde qui se transforme ?