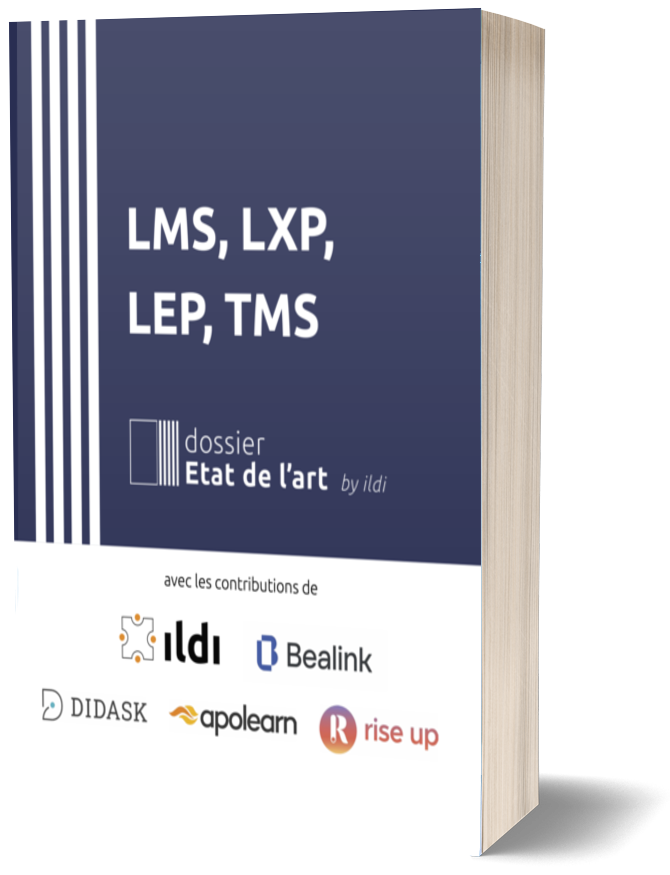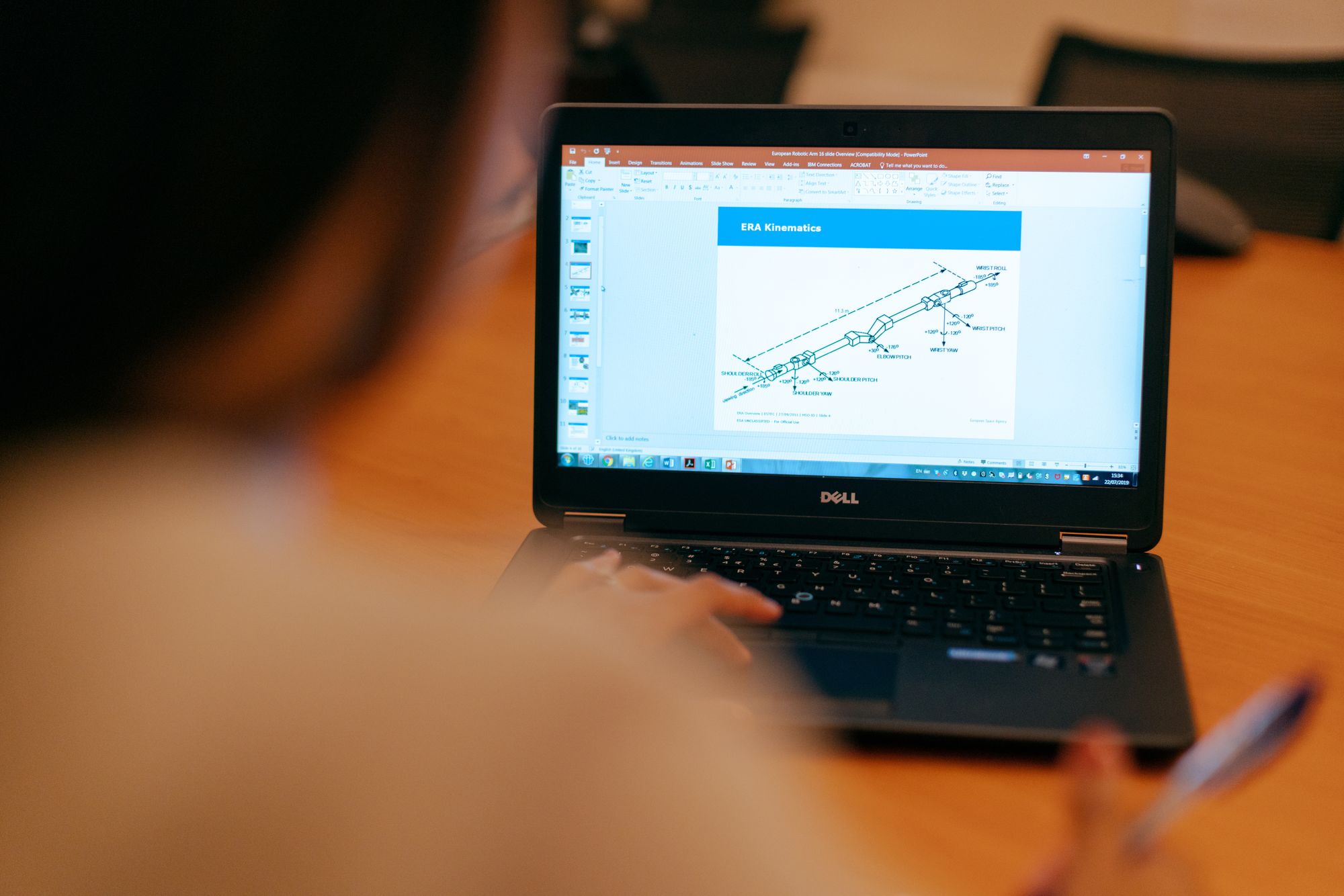
Publié dans : Méthodes et organisation
Comme le montre la revue de la littérature de Maureen Ebben & Julien S. Murphy (2014), on peut observer deux phases dans les recherches et travaux à propos des MOOC, chacune avec des impératifs et des thèmes de recherche associés. La première phase, 2009-2011/2012, est celle des MOOC connectivistes, de la créativité et de l’engagement dans le processus de production. Durant cette phase, les recherches portent sur le connectivisme comme une théorie de l’apprentissage, et l’expérimentation des innovations technologiques dans les premiers cMOOC. La deuxième phase, entamée dès 2012, voit la montée de xMOOC, la poursuite du développement des plates-formes de MOOC, la croissance de l’analyse et de l’évaluation de l’apprentissage (learning analytics), et l’émergence d’un discours critique sur MOOC. Avec Eric Uyttebrouck (CAP, Université libre de Bruxelles), nous nous sommes à l’époque inscrits dans ce dernier courant, celui d’une approche critique des cours en ligne ouverts et massifs.
Critique de l’innovation technopédagogique dans l’enseignement supérieur : le cas des Massive Open Online Courses
I. Introduction
L’année 1994 restera sans doute dans les annales de l’humanité pour la naissance du World Wide Web. Cette même année, William Geoghegan, consultant chez IBM, lance un pavé dans la mare des technologies éducatives en tentant d’expliquer la faillite persistante des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) à pénétrer le monde de l’enseignement supérieur, malgré plusieurs décennies d’efforts et d’investissements massifs : « During the last decade and a half, American higher education has invested about $70 Billion in information technology goods and services, as much as $20 Billion of which has gone to the support of teaching and learning. But despite the size of this investment (…) no more than five percent of faculty utilize information technology in their teaching as anything more than a ‘high tech’ substitute for blackboard and chalk, overhead projectors, and photocopied handouts. Promising innovations rarely propagate beyond the innovators themselves » (Geoghegan, 1994). Une vingtaine d’années plus tard, rien ne semble avoir changé : chaque nouvelle technologie apporte son lot de promesses qui s’évanouissent de plus en plus vite. Dernier exemple en date : les Massive Open Online Courses (MOOC). Si ces dispositifs portaient – et portent encore pour certains – des espoirs de révolution des méthodes d’enseignement et d’apprentissage, de démocratisation de l’accès au savoir et de nouvelles perspectives de recherche, même les plus fervents « MOOC-aholic » perdent leurs illusions. C’est le cas de Sebastian Thrun qui déclarait, il y a un an, « MOOCs are a lousy product » alors qu’il est lui-même l’un des piliers fondateurs de ce type de dispositif avec son cours d’intelligence artificielle qui avait attiré 160.000 personnes.
II. L’innovation technopédagogique comme espace d’intéressement
Le monde n’a pas attendu Geogeghan pour constater que les enseignants du supérieur restent majoritairement frileux lorsqu’il s’agit d’intégrer les technologies dans leur enseignement, même si ces dernières continuent d’alimenter le mythe de la révolution de l’enseignement supérieur. Si le chiffre précis de 5% d’enseignants utilisateurs que cite Geogeghan n’est appuyé d’aucune référence sérieuse, le constat global est cependant étayé par de nombreuses recherches (Karsenti et al., 2011). En réalité, les seules technologies ayant réellement pénétré le monde de l’enseignement sont celles qui, à l’origine, ont été conçues pour d’autres buts et détournées au profit d’un usage pédagogique – les outils à potentiels cognitifs (Depover, Karsenti et Komis, 2007). Le cas le plus emblématique s’avère sans doute PowerPoint de Microsoft, le logiciel le plus utilisé par les enseignants du supérieur dans le cadre de leurs cours aujourd’hui, mais conçu à l’origine sans attention pour le monde de l’enseignement.
III. Un espace d’intéressement technocentré
Au regard des mutations actuelles de l’enseignement supérieur – massification du public, diversification de ses caractéristiques, profusion de nouvelles technologies, nécessité de développer de nouvelles compétences chez les étudiants, etc. –, l’innovation devient une quasi nécessité pour relever les défis de ce contexte (Poumay, 2014). De nombreux auteurs indiquent que « l’innovation (en pédagogie) concerne tout ce qui ne relève pas de l’enseignement magistral » (Lison et al., 2014). Dès lors, elle tient plus à la capacité de se démarquer de la norme du contexte dans lequel elle s’inscrit que d’effectuer des activités qui n’ont jamais été organisées (Poumay, 2014). Qui plus est, comme le soulignent Bédard et Béchard (2009, cités par Poumay, 2014), innover devrait idéalement signifier « chercher à améliorer substantiellement les apprentissages des étudiants en situation d’interaction« . Néanmoins, rares sont les projets d’innovation technopédagogique qui mettent au cœur de leurs priorités cette volonté d’amélioration des apprentissages. Ce type d’innovation est avant tout technocentrée ; elle génère un espace d’intéressement où la convergence des intérêts porte davantage sur la mise en place d’une « nouvelle » technologie à tout prix que sur la pédagogie ou, encore moins, l’apprentissage. Si les entreprises technologiques voient dans l’éducation un marché particulièrement lucratif, les enseignants innovateurs se lancent par technophilie, les institutions investissent dans ces outils avec, bien souvent, des souhaits de réduction des coûts ou de communication extérieure, les services de soutien suivent par volonté de subsistance et de changement, etc. Ainsi, des justifications personnelles, éducatives, professionnelles, technopédagogiques, institutionnelles, voire sociétales émanant d’acteurs différents trouvent un point de convergence dans la mise en œuvre institutionnelle de la technologie au sein des établissements d’enseignement supérieur. Loin de répondre à des besoins clairement identifiés – notamment en matière d’enseignement et d’apprentissage –, il s’agit surtout de mettre en avant un outil technologique et de s’y investir pleinement. Ce scénario est récurrent dans les technologies éducatives et, plus encore, dans l’enseignement supérieur : « Son introduction (celle d’un nouvel outil technologique) en formation vise à mettre en valeur la capacité d’adaptation et de modernisation des établissements; le discours du politique va dans le même sens, (…) au bout d’un certain temps, de plus en plus court, un autre objet apparaît reléguant le précédent avant toute généralisation ou analyse cumulative des pratiques observées, sans évaluation ni bilan prospectif des acquis et des pertes associés à ces pratiques et finalement, sans effet significatif sur les structures ou le fonctionnement de l’institution. (…) Le dernier objet venu balaie rapidement les espoirs et déceptions soulevés par le précédent et les problèmes de fond demeurent. » (Albero, 2011, p. 15).
IV. Le cas des massive open online courses
Nés en 2008, les MOOC, pour Massive Open Online Courses, gagnent leurs lettres de noblesse dans le courant de l’année 2012, proclamée « The year of the MOOC » par le New York Times. Depuis lors, l’actualité dans le monde de l’enseignement supérieur, anglo-saxon ou francophone, a entièrement été captée par ces « nouveaux » dispositifs et a fini par persuader de nombreux décideurs d’institutions universitaires à se lancer dans la production de tels cours. Comme le souligne Boullier, « Il fallait donc suivre, rattraper notre retard, comme toujours et dès lors copier en Europe ce qui existait au USA sous peine de vie ou de mort. » (Boullier, 2014). Toutefois, si l’engouement des MOOC reste palpable – France Université Numérique, la plateforme du Ministère français de l’Education nationale, compte chaque mois de nombreuses ouvertures de cours offerts par de nouveaux établissements –, des voix dissonantes se font entendre. En effet, les espoirs de démocratisation de l’enseignement s’amenuisent au regard des taux d’abandon très élevés, des faibles impacts sur l’apprentissage – plus pauvres que l’apprentissage en présentiel – ou encore du public, largement dominé par des personnes déjà diplômées.
V. Conclusion
Quelles sont les perspectives pour l’innovation technopédagogique dans l’enseignement supérieur ? Comment développer de tels projets institutionnels qui favorisent le développement professionnel des enseignants et l’amélioration des pratiques d’apprentissage ? Comment dépasser l’amnésie collective à propos des travaux de recherche sur lesquels peuvent s’appuyer ces innovations ? En matière de MOOC, Cisel (2014) écrivait il y a peu : « Le phénomène n’en est qu’à sa préhistoire ; les technologies employées sont encore rustiques, et les connaissances scientifiques commencent à peine à prendre forme. » Il s’agit, selon nous, d’une erreur. En effet, ces Massive Open Online Courses sont un nouvel avatar de l’apprentissage à distance, de la formation en ligne, voire de la formation ouverte et à distance ; dispositifs pour lesquels une vingtaine d’années de recherche ont permis de mieux appréhender les pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Pourtant, à l’instar de cette citation, l’impression ressentie est que chaque nouvelle technologie efface les connaissances acquises avec la précédente. L’exemple le plus parlant est probablement celui des « SPOC », les Small Private Online Courses, des cours en ligne pour un petit groupe privé qui se définissent comme une adaptation locale et fermée d’un MOOC ou, autrement, comme un cours e-learning tel qu’il en existe depuis plus d’une vingtaine d’années.
—————
Repéré depuis https://www.onemoreespresso.be/mooc-une-innovation-pedagogique-ephemere/amp/