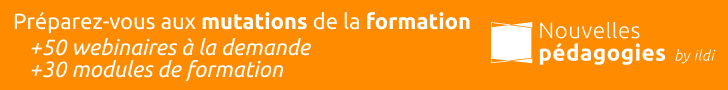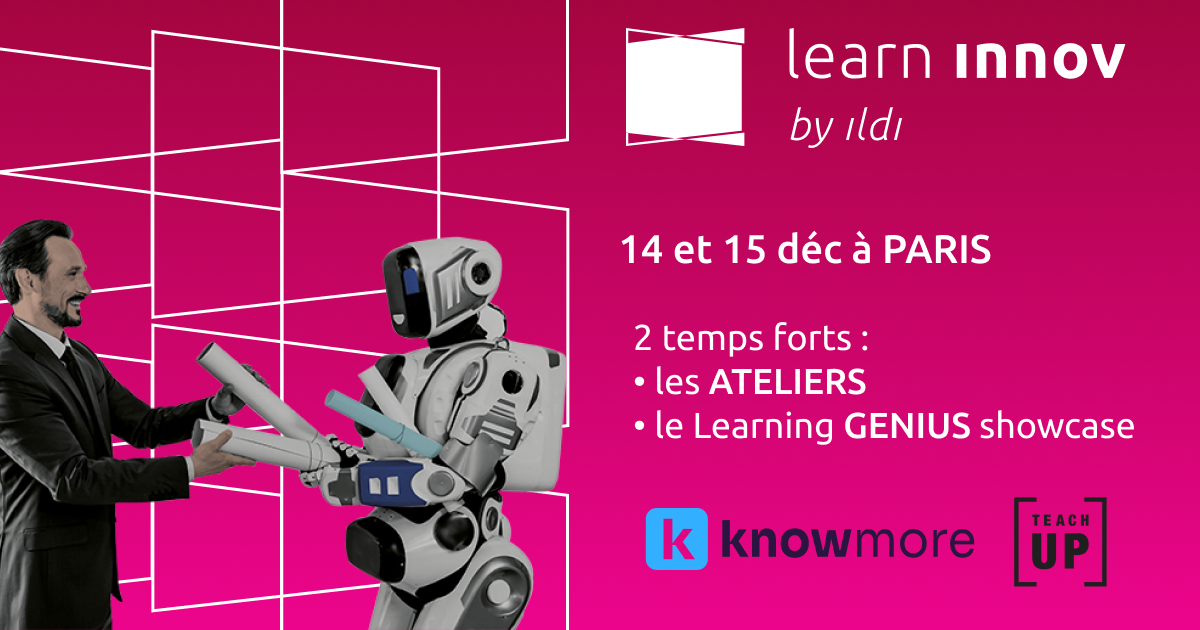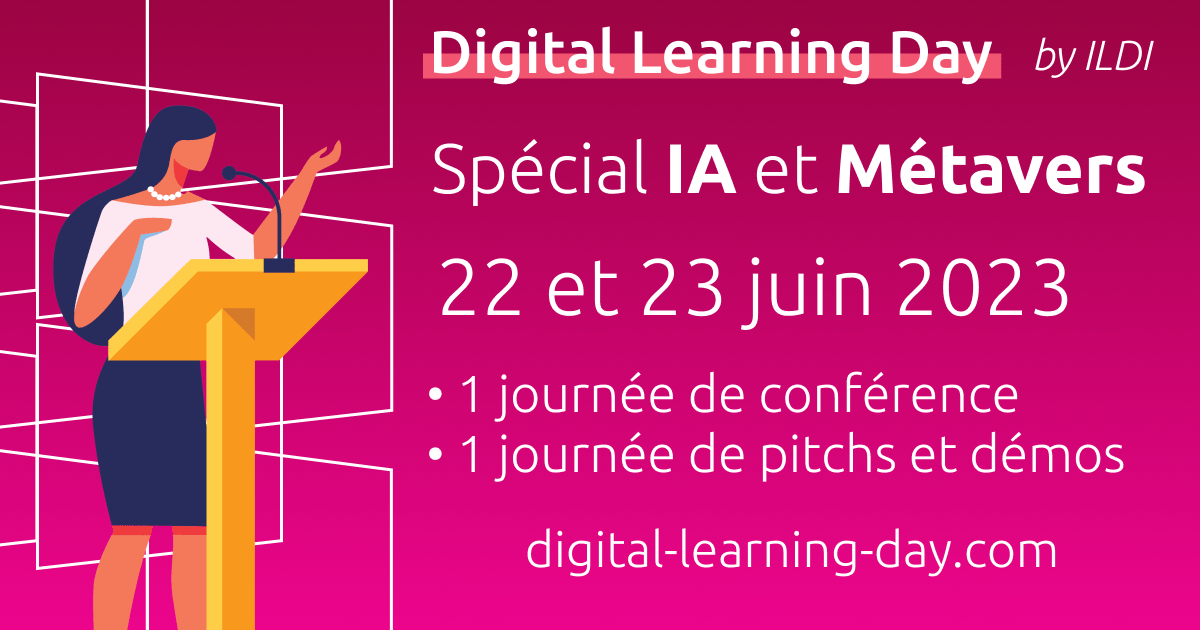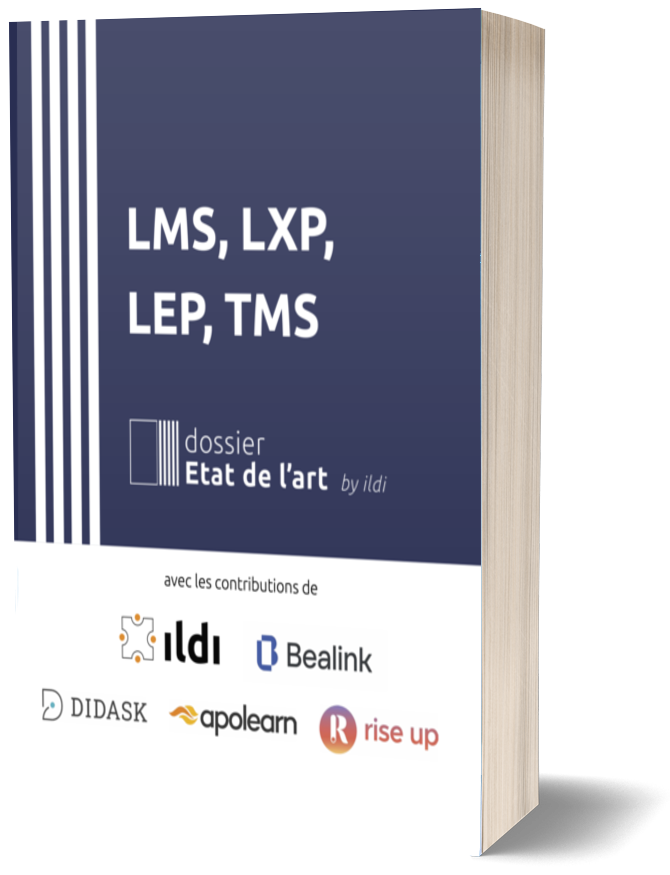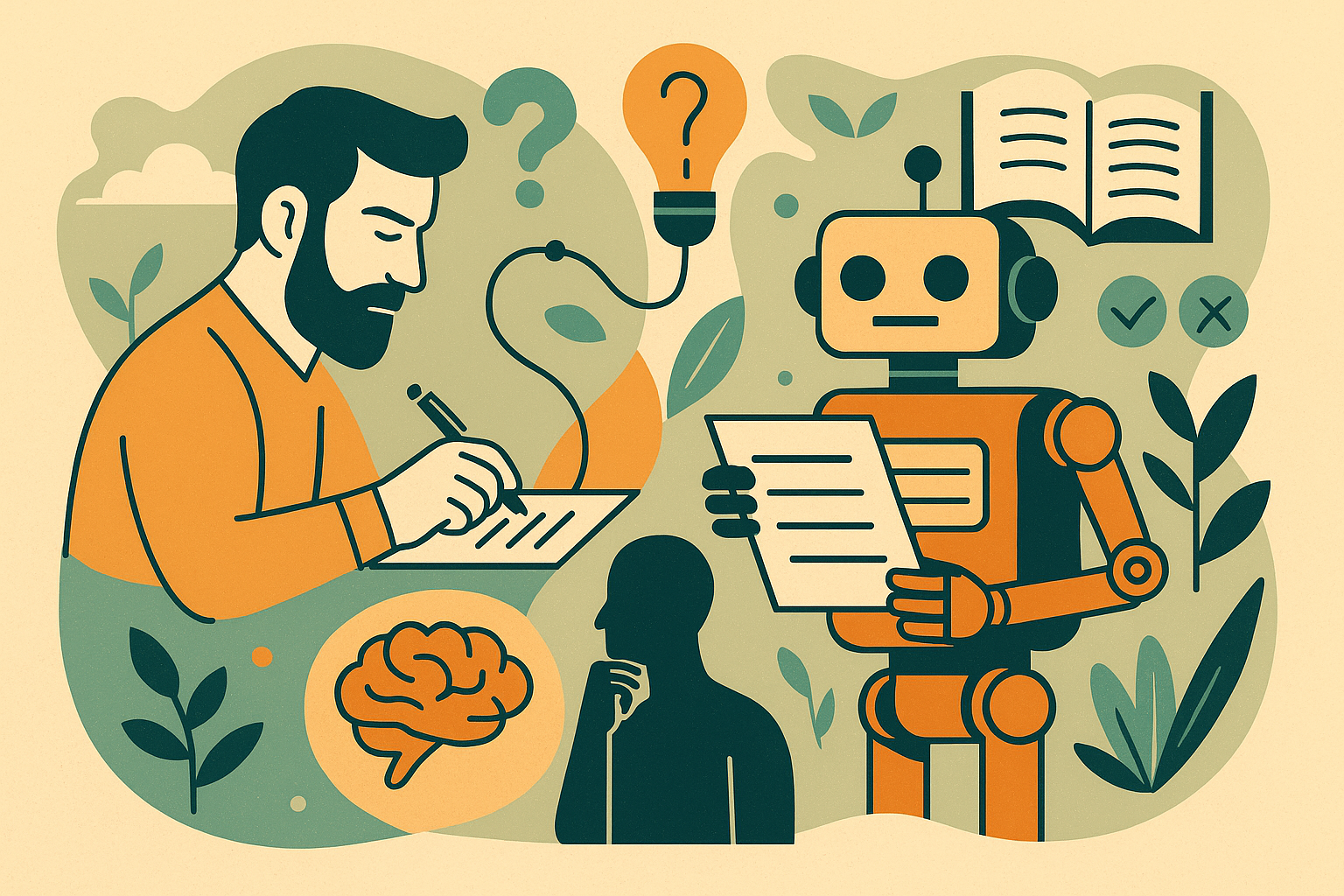
Publié dans : Cognition et Communication
L’utilisation de l’intelligence artificielle pour rédiger des contenus suscite de plus en plus de débats, notamment sur ses effets à long terme sur nos compétences en écriture et en pensée critique. Si ces technologies permettent de gagner du temps, elles soulèvent également des questions sur notre dépendance croissante à leur égard et sur l’érosion possible de notre capacité à rédiger, mais aussi plus globalement de notre créativité et notre capacité à penser.
La rédaction : un acte de pensée et de création
À première vue, la rédaction peut sembler n’être qu’une simple activité mécanique qui consiste à organiser des mots en phrases, tout ça pour communiquer une idée. Pourtant, lorsqu’on y regarde de plus près, rédiger c’est bien plus qu’un vulgaire agencement de mots. C’est un acte de pensée (donc essentiellement un acte humain, on y reviendra plus tard), un processus créatif qui mobilise notre capacité à structurer, analyser et donner du sens. On parle de dimension heuristique de l’écriture : c’est en écrivant que je découvre ce que je veux dire, voire ce que je pense.
L’IA et la nature de la rédaction
Face à cette définition, l’arrivée de l’intelligence artificielle soulève des questions fondamentales : peut-on encore parler de rédaction lorsque le processus est en partie délégué à une machine ? La rédaction n’est-elle pas censée refléter une émotion, une pensée, deux concepts profondément humains ? Si l’IA peut, à n’en pas douter, générer des textes cohérents et bien structurés, peut-on quand même parler de “rédaction” à proprement parler ? Ces productions possèdent-elles une profondeur d’intention et de réflexion ? Si oui, est-elle la même que celle d’un humain ?
Si rédiger est un acte de pensée, alors l’usage excessif de l’IA pour produire des textes pourrait non seulement affaiblir notre capacité à rédiger mais plus profondément à structurer et développer nos idées : à penser, au final.