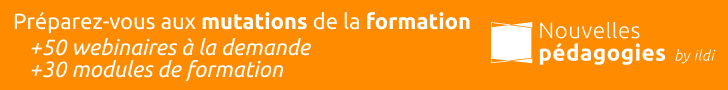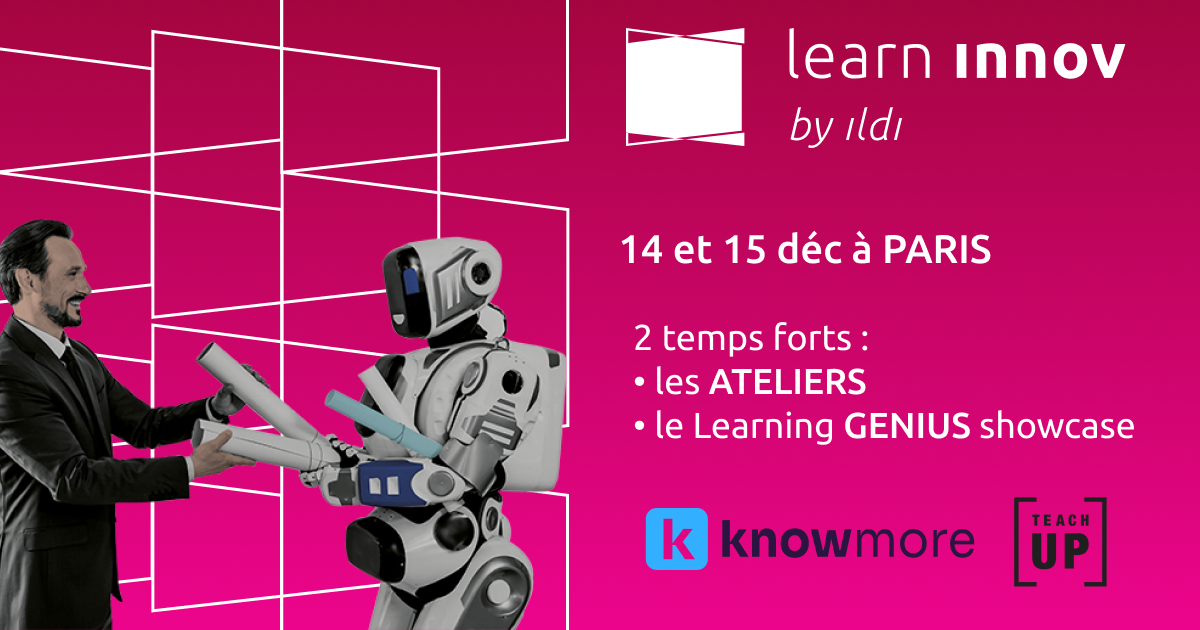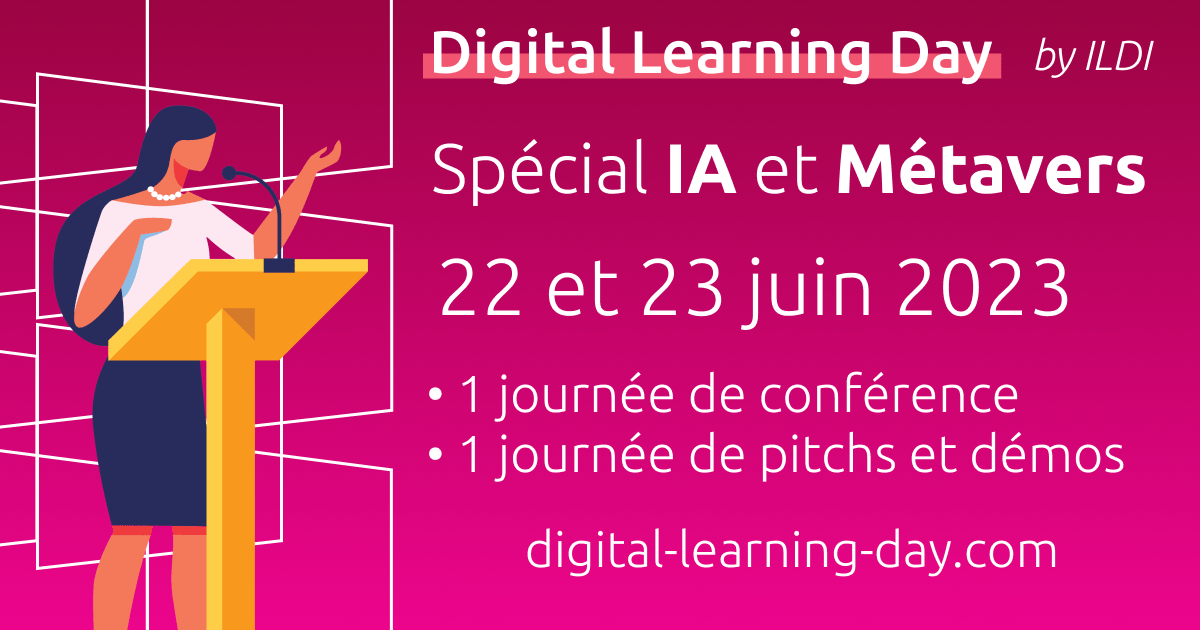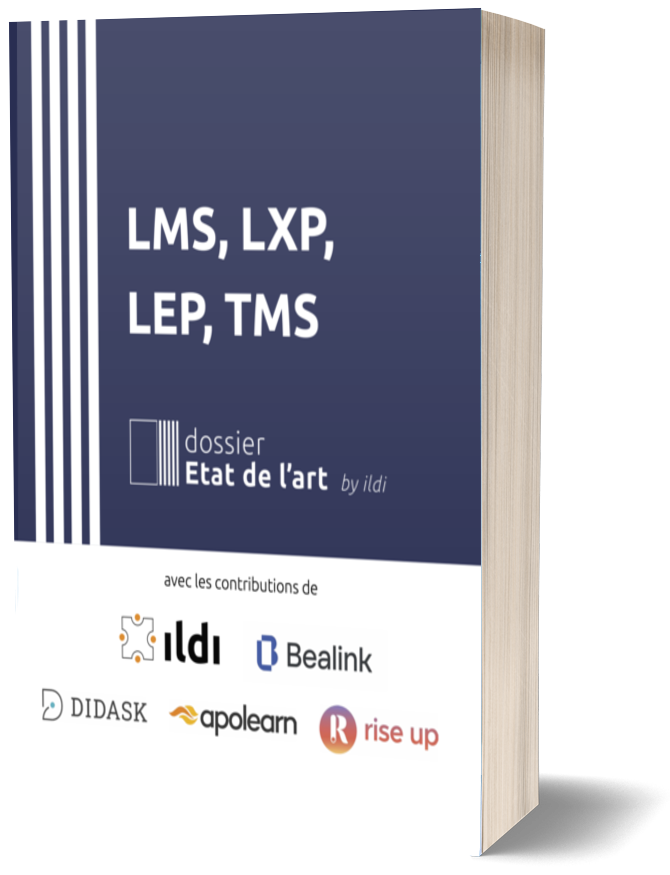Publié dans : Méthodes et organisation
Converser avec l’IA : coût écologique et éthique
Si l’IA générative séduit par sa capacité à produire du texte ou à traduire instantanément, elle comporte des coûts cachés. S’entraîner à formuler des requêtes (prompt en anglais) amène à une interaction langagière qui mobilise d’immenses ressources humaines, matérielles et énergétiques, souvent invisibles à l’utilisateur. La Direction de région académique du numérique pour l’éducation de l’académie de Versailles rappelle aux enseignants que :
- une requête d’environ 400 tokens sur ChatGPT/GPT-4o mini consomme environ 2 Wh d’électricité (ou 2 g de CO2 rejeté), soit plus de 6 fois la consommation d’une recherche Google classique estimée à 0,3 Wh ;
- la création d’une image en haute définition par une IA consomme autant d’énergie que la recharge complète d’un téléphone portable ;
- les centres de données (data centers) liés à l’IA et aux cryptomonnaies ont consommé près de 460 TWh d’électricité en 2022, soit environ 2 % de la production mondiale.
Qui possède les mots, les expressions, les récits mis à disposition sur Internet ? Dans quelle mesure la réutilisation de ces ressources respecte-t-elle le droit d’auteur, la rémunération des créateurs ou encore la diversité linguistique et culturelle ?
Une machine à (re)produire des inégalités langagières ?
L’arrivée des LLM a pu apparaître, dans le mandat de l’Unesco, comme une forme de démocratisation : « La promesse de « l’IA pour tous » doit permettre à chacun de bénéficier de la révolution technologique en cours et d’accéder à ses fruits, notamment en termes d’innovation et de connaissances. » Cette « IA pour tous » offrirait à chaque apprenant des outils disponibles en permanence (correcteur virtuel, un traducteur instantané, etc.), pouvant s’adapter à des besoins particuliers (élèves allophones, troubles du spectre autistique, un TDAH).
Dans une étude récente, des chercheurs en sociologie de l’information à l’Université de Stanford montrent que les auteurs de textes scientifiques en anglais, dont ce n’est pas la langue première, sont défavorisés dans l’évaluation scientifique, leur style d’écriture étant jugé de moindre qualité. L’arrivée de ChatGPT réduit légèrement ces biais en améliorant la traduction tout en contribuant à déplacer ces inégalités, non plus sur la maîtrise de l’anglais, mais sur l’hypothèse d’un usage de l’IA dans la production de ces textes. On imagine aisément un tel phénomène dans les évaluations scolaires.